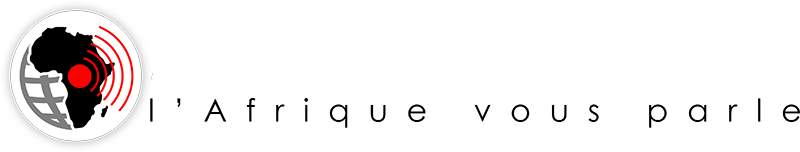Harcelement sexuel en Côte d’Ivoire : Voici pourquoi les femmes n’osent pas en parler.
Faute d’être suffisamment protégées par le système judiciaire, les Ivoiriennes renoncent le plus souvent à dénoncer les agressions sexuelles qu’elles subissent.
Il y a d’abord cette étrange impression d’observer une tempête, de loin. De n’être que spectateur. En octobre 2017, lorsque les mouvements #metoo et #balancetonporc démarrent aux Etats-Unis et en France avant d’atteindre de nombreux pays, la Côte d’Ivoire, elle, y reste quasi hermétique. Femmes politiques, femmes d’affaires, actrices, « influenceuses »… aucune langue ne se délie.
Il y a ensuite les chiffres, implacables. La société américaine d’analyse des médias sociaux Crimson Hexagon, qui a compilé les données relatives aux deux hashtags sur Facebook, Twitter et Instagram, rapporte qu’entre le 4 octobre et le 6 novembre 2017, seuls 215 posts mentionnant le hashtag #balancetonporc et 76 #metoo provenaient de Côte d’Ivoire. Les résultats, plus faibles encore dans les autres pays africains francophones à l’exception notable du Sénégal, sont en revanche loin de ceux affichés par des pays anglophones – il est vrai plus peuplés – tels que l’Afrique du Sud (8 500 posts) ou le Kenya (près de 2 000). A titre de comparaison, sur la même période, les Etats-Unis et leur #metoo dépassaient les 500 000 posts et la France les 100 000 avec #balancetonporc.
Un an plus tard, en Afrique et en Côte d’Ivoire en particulier, la tendance n’a pas changé. La majorité des personnalités féminines ivoiriennes que Le Monde a contactées ont d’ailleurs poliment décliné l’opportunité de témoigner ouvertement. « Les gens sont très susceptibles en Côte d’Ivoire. Sur ce sujet, je préfère garder mon opinion pour moi », explique une célèbre mannequin, sous couvert d’anonymat.
« #metoo ne peut pas prendre ici, car c’est un mouvement qui n’est pas adapté à nos réalités, avance Honorine Véhi Touré, présidente de l’association Génération femmes du troisième millénaire. D’abord parce que c’est un mouvement très numérique et urbain, alors que la majorité des femmes ivoiriennes, notamment en milieu rural, ne sont pas sur les réseaux sociaux aujourd’hui. » L’exemple de Facebook est révélateur. Sur les 4,3 millions d’utilisateurs réguliers du réseau social dans le pays (soit 17 % de la population), seuls 33 % sont des femmes, selon le rapport « Digital in 2018 » des agences Hootsuite et We Are Social.
Mme Véhi Touré poursuit :
« Ensuite parce que dénoncer publiquement un homme qui vous a harcelée ou agressée, c’est facile à faire quand vous êtes en Occident… Mais ici, le climat sécuritaire est différent. Il vous faudra affronter les représailles, parfois physiques, de votre bourreau, de sa famille. Tant que les femmes ne se sentiront pas véritablement protégées par la police et le système judiciaire, elles ne parleront pas. »
Depuis 1998, la loi ivoirienne punit le harcèlement sexuel d’une peine d’un à trois ans de prison et d’une amende de 360 000 à 1 million de francs CFA (de 550 à 1 525 euros). Le viol, lui, est passible d’une peine de cinq à vingt ans de prison. Mais dans les faits, les plaintes et surtout les condamnations sont peu nombreuses. Dans une enquête publiée en juillet 2016, l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (Onuci) et le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme révélaient que sur 1 021 procédures judiciaires ouvertes pour des viols commis entre 2012 et 2015 et suivies par ces organisations, seules 18 % avaient abouti à des jugements.
Exigence par la police d’un certificat médical payant, encombrement des tribunaux et surcharge des prisons après la crise politico-militaire qu’a connue le pays entre 1999 et 2011, manque de moyens de la justice, etc. : les raisons sont multiples et largement suffisantes pour freiner les victimes dans leur volonté de poursuites.
Mais au-delà des dimensions sécuritaire et judiciaire, #metoo s’est aussi fracassé sur des particularités sociétales et culturelles bien ivoiriennes. « #metoo, c’est un phénomène que je regarde avec un œil plutôt curieux et que je ne vois pas du tout prospérer dans un pays comme le nôtre, où le regard de la société est si prégnant », déclare Christelle Aman-Koffi, jeune quadragénaire, cadre supérieure dans une agence étatique ivoirienne :
« D’autre part, la dépendance économique d’une majorité des femmes envers les hommes les a conduites à intégrer l’idée qu’elles ne pouvaient s’en sortir dans leur vie ou leur travail qu’à travers les hommes, et du coup à tout accepter d’eux : drague lourde, maltraitances… Dans le milieu du travail, chez les plus jeunes notamment, on voit même de plus en plus de femmes inverser le processus et se servir d’une féminité plus qu’assumée pour obtenir rapidement des avantages. »
« Les femmes aiment quand on insiste ici », « Vous importez un débat et des problématiques occidentales », « Il y a d’autres priorités dans le pays »… Laura Mel, 28 ans, journaliste franco-ivoirienne qui a longuement enquêté sur le harcèlement sexuel à Abidjan en 2017, se souvient encore des réactions suscitées par ses questions :
« Pour la plupart de mes interlocuteurs et interlocutrices, le plus important n’était pas le harcèlement en lui-même mais le fait d’en parler. A tel point qu’à un moment donné, je me suis demandé si je n’étais pas à côté de la plaque et si je ne surinterprétais pas toutes ces remarques, ces gestes déplacés que supportent au quotidien les Abidjanaises. »
Comme la plupart des débats de société agitant les pays occidentaux (mariage pour tous, euthanasie…), #metoo est perçu par beaucoup comme un débat importé, imposé, auquel les Ivoiriens et les Africains en général ne sont pas obligés de participer. Cette carte de la « différence culturelle » brandie devant le débat suscité par #metoo, Bénédicte Joan, 29 ans, Congolaise qui vit à Abidjan depuis cinq ans, a décidé de la contourner plutôt que de la combattre. Début 2018, elle a monté un collectif afin d’aider les victimes d’abus sexuels.
« Après avoir vécu moi-même une mauvaise expérience, explique-t-elle en précisant ne pas vouloir s’y attarder, j’ai commencé à parler de harcèlement et d’agressions sexuelles autour de moi et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes en avaient été victimes et que cela avait eu un impact important sur leurs vies, certaines décidant de ne pas se marier, d’autres de ne plus avoir de rapports sexuels. »
Le collectif a rapidement atteint « près de 200 membres, hommes et femmes », selon son initiatrice. Des séances de coaching, des ateliers, un groupe WhatsApp et un numéro vert sont proposés à ceux qui souhaitent partager leurs histoires, et une application est en cours d’élaboration. Son nom ? « Stop au chat noir », en référence à cette expression typiquement ivoirienne, « faire chat noir », qui désigne la manière dont certains hommes se rendent la nuit, silencieusement, dans la chambre d’une femme pour obtenir, parfois sous la contrainte, ses faveurs sexuelles.
« Cet entre-soi, cette confidentialité que permet de préserver le groupe, c’est un peu le reflet de nos cultures africaines, où le “ce qui se passe à la maison reste à la maison” prédomine, décrypte Bénédicte Joan. Plutôt que de les préparer à s’attaquer en public à leurs agresseurs dans un contexte où nos sociétés, nos familles, ne sont pas encore prêtes à cela, nous leur apportons un soutient mental pour qu’elles puissent, au moins, entamer leur guérison. »
Source : le monde fr