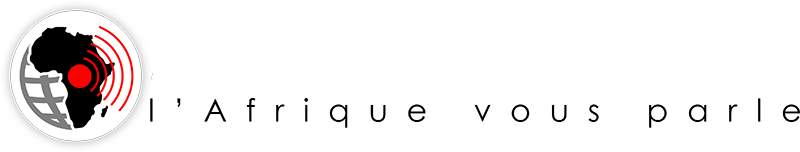Paul Kagame : «Nous ne voulons pas rester otages de notre histoire»
A Paris à l’occasion du Forum pour la paix, le président rwandais insiste sur l’importance du développement et de l’indépendance économique en Afrique. Et évoque ses relations avec la France, longtemps troublées par les fantômes du génocide de 1994.
Décidément, les temps changent : dimanche, lors du déjeuner offert par la présidence française en marge des commémorations du 11 Novembre et du Forum pour la paix, le président rwandais, Paul Kagame, figurait parmi les quatre chefs d’Etat africains invités à s’asseoir à la table d’honneur. Le Rwanda est souvent présenté comme un modèle de développement réussi, ce qui n’est sans doute pas pour déplaire à Emmanuel Macron. Mais le Rwanda, c’est aussi le pays d’une tragédie : celle du génocide de la minorité tutsie, qui a fait 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Kagame, aujourd’hui âgé de 61 ans, a d’abord été ce chef rebelle qui a mis un terme aux massacres. Mais depuis sa prise de pouvoir, il a souvent été brouillé avec Paris, qu’il a accusé de complicité avec les forces génocidaires de son pays. L’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Elysée semble ouvrir une nouvelle page dans cette relation tourmentée. Certains s’en réjouiront, d’autres le déploreront. Car rarement un leader africain aura suscité autant de réactions passionnelles. Diabolisé par les uns, adulé par d’autres, le président du Rwanda évoque pour Libération sa vision des changements en cours et répond, au passage, à ceux qui le critiquent.
Vous avez assisté dimanche à la première journée du Forum pour la paix. Cette initiative peut-elle avoir une réelle utilité ?
L’idée maîtresse de cette première journée a été la nécessité d’imposer plus de multilatéralisme. C’est une bonne chose, mais le monde actuel reste divisé entre ceux qui ont trop de pouvoir et imposent les règles, et ceux qui les subissent et doivent les appliquer. Ces derniers font partie du monde d’où je viens : le monde de l’Afrique et, plus généralement, des pays sous-développés. Mais désormais, même les Etats qui ont trop de pouvoir sont divisés ! C’est la philosophie du «moi d’abord» qui domine ouvertement. Personne ne fait même plus semblant de parler au nom du bien et du mal. Et cette prédominance affichée des intérêts égoïstes se répercute dans les pays en développement, devenus un terrain de compétition, ce qui contribue à l’instabilité globale de la planète.
L’Afrique serait donc une victime du nouvel ordre mondial ?
Elle doit aussi regarder ses faiblesses et se réformer. Si l’Afrique veut peser sur la scène mondiale, elle doit renoncer de la même façon à la tentation du «moi d’abord», renforcer son intégration. Mais avant toute chose, il faut qu’elle s’attelle à prendre réellement en compte les besoins des peuples. Il faut être soi-même, sans dépendre systématiquement de l’aide de l’Occident. Au Rwanda, quand on a mis en place la couverture médicale pour tous, avec des cotisations variables selon les revenus, certains donateurs nous ont proposé de financer celles des plus démunis. Nous avons refusé, parce que nous considérons que même les plus pauvres doivent s’approprier ce système et payer, ne serait-ce qu’un minimum très modeste. Il faut sortir de la logique de la charité. L’aide n’est pas indigne. Des situations désespérées existent, avec des besoins urgents. Mais il faut aussi offrir aux citoyens les moyens de s’émanciper eux-mêmes, retrouver assez d’espoir pour qu’ils restent chez eux.
En Europe, l’immigration est présentée comme un fléau. Et la démographie galopante du continent africain est ressentie comme une menace qu’il faudrait à tout prix réduire. Vous partagez cette analyse ?
Sur le sujet de l’immigration, on a surtout l’impression que les Occidentaux improvisent des stratégies à très court terme. Le problème, ce n’est pas la démographie, c’est la mauvaise gestion de la démographie, ou plus exactement la mauvaise gouvernance. Avant d’être un défi, la démographie est un atout pour l’Afrique. Moi, j’ai plutôt l’impression que c’est cette jeunesse en plein essor qui va contribuer à changer l’Afrique. On voit bien qu’elle conteste certaines pratiques, bouscule l’ordre des choses. Je garde l’espoir que les générations futures seront meilleures que les nôtres et les précédentes, qui ont contribué au gâchis de ce continent.
Le Rwanda est-il une exception ? Car votre pays a connu, depuis le génocide, un développement impressionnant…
Les changements ont eu lieu très vite au Rwanda, plus vite que je ne le pensais. C’est à présent un pays en paix, réconcilié. Le développement, c’est le ciment sans lequel tous les autres grands principes sont vains. On peut prêcher la réconciliation, le pardon, garantir la justice. Mais ce sont des mots vains si les gens ont faim ou ne sont pas soignés. Je ne dis pas qu’il faut négliger l’un pour l’autre, mais c’est une dynamique.
Reste que le Rwanda est aussi l’objet de critiques sur les atteintes aux droits de l’homme, à la démocratie…
Nous entendons ces critiques, ces exigences, depuis vingt-cinq ans. Ces pressions, je les ai souvent trouvées injustes, prématurées au regard de la tragédie que nous avions vécue. Néanmoins, je reconnais qu’elles ont parfois eu un impact positif. Cela nous a forcés à maintenir le cap. Et aujourd’hui, personne ne viendrait investir dans ce tout petit pays s’il n’y avait pas cette stabilité, cette sécurité. Vous pouvez circuler seul à 4 heures du matin seul à Kigali sans aucun risque.
Ces critiques évoquent pourtant des cas concrets, comme les arrestations de Victoire Ingabire ou de Diane Rwigara, deux femmes qui se sont affichées comme vos opposantes. Et puis il y a cette loi qui aurait été récemment adoptée, interdisant les caricatures de personnalités politiques dans la presse…
Cette loi que vous mentionnez est un exemple typique de désinformation. En réalité, elle date de 1978 ! Elle fait partie d’un corpus de lois réexaminées par le Parlement rwandais. Lequel a ainsi supprimé une autre loi qui limitait l’accès des femmes à l’héritage. C’est un processus en cours. On pourrait nous reprocher de ne pas avoir déjà invalidé cette loi sur les caricatures, mais ce n’est pas le cas ! On nous accuse carrément de l’avoir mise en place. On va finir par la changer, mais c’est un faux procès que l’on nous fait.
Pour les deux femmes que vous avez mentionnées, les cas sont différents, même si on fait souvent l’amalgame. En ce qui concerne Victoire Ingabire [condamnée à quinze ans de prison en 2013, notamment pour «minimisation du génocide de 1994», et libérée en septembre après une remise de peine, ndlr], c’est avec la collaboration décisive de la justice néerlandaise que l’enquête a pu se faire aux Pays-Bas, où Victoire Ingabire a longtemps vécu. On nous a transmis les preuves [de son implication aux côtés de groupes extrémistes], qui ont été présentées à son procès. Son cas est très simple. Quant à Diane Rwigara [qui attend le verdict de son procès en liberté provisoire], il lui est notamment reproché d’avoir voulu se présenter aux élections l’an passé en falsifiant la liste des signatures pour la validation de sa candidature. Visiblement, elle se croyait intouchable, parce qu’elle bénéficie de nombreux soutiens à l’étranger. Ce qui n’est d’ailleurs pas illégal mais pose des questions. Car au fond, depuis vingt-cinq ans, on est souvent confrontés au même schéma narratif, construit et soutenu par des gens liés à l’histoire tragique du Rwanda depuis les années 90. Ils font beaucoup de bruit, tentent de mobiliser contre nous, et ils ont parfois réussi à dissuader certains investisseurs de venir chez nous.
Vous donnez l’impression que le Rwanda, que vous présidez depuis dix-huit ans, est toujours confronté à des forces hostiles…
C’est une réalité. Je n’ai aucun doute là-dessus. Nous avons mis en place des institutions, mais on nous dénie le droit d’appliquer nos propres lois. Pourtant, lorsque je regarde ce qui se passe ailleurs, je suis étonné. En France, depuis 1994, il y a une cinquantaine de personnes suspectées d’avoir participé au génocide, identifiées par la justice française, mais qui n’ont toujours pas été jugées. Ces gens sont-ils innocents ? Est-ce que le système judiciaire français est défaillant ?
Parmi les démêlés judiciaires en France, il y a l’instruction de l’attentat contre l’avion du président Juvénal Habyarimana, le 6 avril 1994, dans laquelle plusieurs de vos proches étaient mis en cause. Après vingt ans de procédure, le parquet de Paris a récemment requis un non-lieu. Etes-vous satisfait ?
Depuis le premier jour, c’est une instruction politiquement motivée qui n’aurait jamais dû avoir lieu. Le dossier a déjà été fermé et rouvert à deux reprises. Nous avons accepté que la justice française vienne enquêter sur place, il y a eu douze déplacements au Rwanda, trois juges qui se sont succédé. Et à la fin ? Rien… Le dossier est vide. Mais ceux qui connaissent la vérité avaient tout intérêt à le maintenir ouvert contre nous. Les responsables, nous les connaissons. Il faut regarder dans une autre direction.
Vers la France ?
Je vous laisse libre de vos conclusions…
On sent bien que depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron, vos accusations contre la France sont devenues plus modérées…
Vous voudriez que je répète toujours la même chose ? Je ne vais pas perdre mon temps à demander une reconnaissance du passé, qui ne viendra peut-être jamais. A chacun de regarder sa conscience. Les faits sont là, je vis avec, et je gère ça de façon à continuer à avancer. Nous ne voulons pas rester les otages de notre histoire. Reste que la France de 1994 n’est pas la même que celle d’aujourd’hui. Ceux qui dirigent désormais le pays ne sont pas impliqués dans ce qui s’est passé hier. Et c’est vrai qu’Emmanuel Macron appartient à une autre génération, avec une mentalité différente, une nouvelle approche.
SOURCE:https://www.liberation.fr/planete/2018/11/12/paul-kagame-nous-ne-voulons-pas-rester-otages-de-notre-histoire_1691650