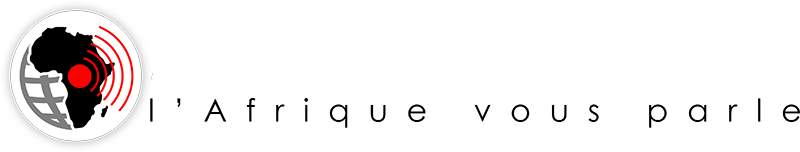Energie/Un patron de l’industrie du pétrole se fâche
C’était il y a un an, tout juste. Sous le double effet de la crise sanitaire et économique, les cours du pétrole s’enfonçaient dangereusement sous les 25 dollars, plongeant la profession dans la stupeur. Aujourd’hui, le prix du baril est revenu au niveau qui était le sien avant la pandémie. Une normalité de surface. Car les douze mois qui viennent de s’écouler ont bousculé bien des certitudes chez les majors de l’or noir, en plein doute existentiel. Au terme d’une année mouvementée pour les grands noms du pétrole, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, entend prendre « un autre chemin » et se positionne désormais comme un acteur de l’électricité et des renouvelables. Un virage spectaculaire que prend l’un des patrons du pétrole.
L’année 2020 a été exceptionnelle à plus d’un titre. Pour le secteur pétrolier, elle reste marquée par la dégringolade historique des cours du baril, qui sont même devenus négatifs au mois d’avril dernier. Pensez-vous que la situation est redevenue normale ?
Si les cinq dernières années nous ont appris une chose, c’est bien qu’il n’y a pas de cours « normal » du pétrole. Nous sommes passés d’un monde où le prix du brut semblait durablement installé entre 80 et 100 dollars le baril, à une séquence inédite, qui a vu les cours chuter à moins de 20 dollars dans les premières semaines de la pandémie, avant de remonter aujourd’hui autour de 60 dollars…

On le voit bien, ce qui caractérise le marché pétrolier, c’est avant tout son extrême volatilité, et il nous faut vivre avec cette nouvelle réalité. Pour être honnête, je suis un peu surpris du niveau de prix actuel, relativement élevé. Je ne vais pas m’en plaindre, mais je ne suis pas sûr qu’il soit durable, et qu’il reflète les fondamentaux du marché. Partout sur la planète, on sent une volonté de positiver, de revenir le plus rapidement possible à la vie « normale » grâce aux campagnes de vaccination, ce qui est assez naturel après un an de pandémie. Mais ce scénario optimiste, je ne le lis pas encore dans les chiffres. Je reste donc assez prudent pour les mois à venir.
Dans l’hypothèse d’une reprise rapide et soutenue, certains observateurs prédisent une brutale remontée des prix du pétrole, faute d’une offre suffisante. Ont-ils raison de s’inquiéter ?
C’est un scénario possible, oui, et ce n’est pas nécessairement celui que je préfère… On nous a beaucoup expliqué que le monde d’après serait différent. Il y a toutes les chances, au contraire, que la sortie de crise se traduise par un redémarrage spectaculaire de la consommation, des déplacements, donc de la demande de pétrole. Et là, nous avons un problème, effectivement, car l’offre risque d’avoir du mal à suivre.
Depuis cinq ans, tous les acteurs de l’industrie pétrolière traversent des crises, naviguent dans un environnement incertain et doivent composer avec l’exceptionnelle volatilité des cours, ce qui les a amenés à moins investir, à se montrer plus sélectifs, à retarder certaines décisions. Cela ne s’est pas encore fait sentir sur le marché, car la croissance de la production a été globalement assurée par des projets lancés avant 2015. Il est clair que la profession, dans son ensemble, n’investit pas assez. Or, il n’y a pas de secret dans notre industrie : si l’on ne met pas en production de nouveaux gisements, la production décline chaque année de 4 à 5%. Tôt ou tard, cela se paie.
Ce n’est pas près de changer si l’on en juge par les réductions de coûts annoncées cette année encore par les grandes compagnies pétrolières, dont Total…
Réaliser des économies, les compagnies pétrolières, qui génèrent et dépensent des milliards, savent faire. Mais le contexte actuel et les défis qui sont devant nous demandent plus que cela. Ce qui rendra Total plus performant, plus résilient, c’est une combinaison alliant rigueur et discipline sur les coûts, mais aussi une stratégie volontariste, visant à nous positionner sur des actifs traversant mieux les cycles, afin d’abaisser notre point mort, c’est-à-dire le seuil à partir duquel nous gagnons de l’argent.
Ces dernières années, pourquoi nous sommes-nous repositionnés très fortement sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ? Tout simplement parce qu’on y trouve le pétrole le moins cher à produire, c’est un choix délibéré qui nous permet d’afficher un coût moyen de production de 5 dollars par baril, l’un des plus bas de la profession. Et cela se traduit par une baisse spectaculaire de notre point mort : il était supérieur à 80 dollars il y a cinq ans ; aujourd’hui, un baril à moins de 30 dollars nous permet de couvrir nos investissements…
Cette focalisation sur des projets moins coûteux est donc une façon de se protéger de la volatilité du marché. Mais il s’agit aussi de répondre à un autre problème fondamental : celui de l’évolution de la demande de pétrole au-delà de 2030, qui est étroitement liée au changement climatique bien sûr.
A cet horizon, personne n’imagine sérieusement que l’on puisse se passer complètement de l’énergie liquide, mais des substituts apparaissent- les véhicules électriques, les camions à hydrogène – et la décarbonations qui se profile ne peut que faire baisser la consommation d’hydrocarbures. Logiquement, que va-t-il se passer ? On arrêtera les productions les plus coûteuses. De ce point de vue, les enjeux climatiques et financiers se rejoignent, et c’est ce qui guide notre stratégie, aujourd’hui.
Après une année de pandémie, quels enseignements tirez-vous de cette séquence folle ? A-t-elle changé votre façon d’aborder l’avenir ?
Le premier enseignement, c’est que tout peut arriver. Dans notre métier, nous passons beaucoup de temps à établir une cartographie des risques. Et bien je le reconnais, aucun d’entre nous n’avait imaginé le scénario d’une gigantesque pandémie, provoquant en quelques semaines la mise sous cloche de l’économie mondiale. La bonne nouvelle, c’est que cela ne nous a pas empêchés de continuer à produire, et que nos systèmes de crise ont donc bien fonctionné.
La deuxième leçon, c’est que notre monde globalisé est une source de progrès que personne ne peut contester, mais ses interconnexions créent également des fragilités, qui doivent nous amener à réfléchir… La prise en compte de ces phénomènes globaux et de nos vulnérabilités partagées fait naturellement écho aux enjeux climatiques. Et ce n’est pas un hasard si Total décide aujourd’hui d’accélérer sur ce terrain.
En quoi la crise sanitaire a-t-elle été un déclencheur ?
En réalité, le vrai point de bascule a eu lieu un peu avant, c’est-à-dire au mois de septembre 2019, où j’ai assisté au sommet des Nations Unies sur le climat ; un nouveau rapport du Giec tire la sonnette d’alarme, la jeunesse se mobilise autour de Greta Thunberg et je suis entouré de patrons parlant du matin au soir de neutralité carbone. Une atmosphère très particulière, qui m’a fait sentir à la fois l’urgence de la situation et les changements profonds qui se profilaient. Je suis rentré de New York absolument convaincu qu’il fallait nous emparer de ce sujet.
La pandémie, finalement, n’a fait qu’accélérer cette prise de conscience, et nous a permis de formaliser les choses. Les tops managers de Total n’ont jamais eu autant le temps de réfléchir et de travailler ensemble que pendant le premier confinement ! Il est sorti de cette période féconde l’envie d’écrire une nouvelle page de notre histoire, et de changer de braquet. J’en ai assez d’appartenir au club des pétroliers que tout le monde secoue, tout le monde déteste ; marre d’être sans cesse sur le mode défensif.
Prenons le sujet de la transition énergétique à bras-le-corps, en étant offensifs et positifs. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de rebaptiser Total en Total Energies. Changer de nom, ce n’est pas rien. C’est le signe que de nombreux tabous sont en train de tomber.
On imagine que les pressions exercées par certains investisseurs clés dont des banques, des fonds souverains, des gestionnaires d’actifs – ne sont pas étrangères non plus à ce changement de pied…
Le système tout entier pousse au changement, et c’est bien ce que traduit l’évolution à la baisse des cours du Bourse des acteurs pétroliers. Si je me réfère à des critères purement financiers, je peux m’étonner que des électriciens deux fois plus endettés que Total, et générant trois fois moins de cash, soient mieux valorisés que nous. Mais finalement le marché boursier nous dit deux choses, à savoir, la volatilité de votre activité, donc de vos résultats, pose problème, agissez pour la maîtriser ; et surtout, compte tenu des enjeux climatiques, votre business est-il durable ?
Interrogation légitime. Oui, la question de la pérennité d’une entreprise pétrolière est posée. Et vis-à-vis de mes salariés, de mes actionnaires, je me dois d’y répondre. Je dois démontrer qu’un autre modèle est possible, ne reposant plus seulement sur les énergies fossiles.
Plus seulement, mais qui reposera encore sur elles pour un certain temps…
Oui, à moins qu’on me demande de fermer complètement le robinet. Et là, c’est un choix de société. Pour quelque temps encore, l’évidence est que nous ne pourrons pas nous passer des énergies fossiles. Nous en avons besoin pour nous déplacer, nous chauffer, nous éclairer, et tant que des alternatives performantes et bon marché ne seront pas disponibles, imaginer que l’on puisse tout arrêter du jour au lendemain est une illusion.
Cela ne doit pas nous empêcher de réinventer nos sources d’énergie. Il y a deux façons de le faire : la première, naturelle pour un groupe comme le nôtre, est de multiplier les efforts pour décarboner les procédés produisant et utilisant des énergies fossiles, réduire les émissions de CO2 et de méthane qui en découlent. Pour Total, c’est un enjeu majeur en termes d’investissements et d’innovation.
C’est également un changement culturel, car désormais la contrainte carbone est intégrée à notre business. Nos collaborateurs ne sont plus seulement incités à produire, à faire des profits ; ils seront également jugés sur leur capacité à réduire notre empreinte carbone. Un sacré changement d’algorithme…
Le deuxième axe de la transition nous amène à nous positionner sur des sources d’énergie durables. Solaire, éolien offshore, terrestre… Depuis quelques années nous nous frottons à ce nouvel univers, par petites touches. Le moment est venu d’accélérer. Massivement. Vous avez noté qu’une nouvelle catégorie d’acteurs était apparue dans le paysage énergétique ? Le «green energy supermajors »… Eh bien je vous le dis, TotalEnergies sera l’une de ces « super majors » vertes. Nous serons dans le Top 5 mondial des renouvelables, parce que nous avons le savoir-faire, et des moyens plus importants que d’autres.
Dans le nouveau paysage que vous nous décrivez, quel peut être l’avantage comparatif d’un groupe comme Total, face à des producteurs d’électricité présents depuis des années sur ces métiers ?
D’abord, comme je viens de vous le dire, nous avons des capacités financières importantes, ce qui n’est pas un détail dans une industrie aussi capitalistique. Nous avons un meilleur bilan que les électriciens, nous sommes moins endettés qu’Enel ou Iberdrola – ceux que l’on présente comme les champions de la transition énergétique. Total peut par ailleurs s’appuyer sur de très nombreux ingénieurs, et sur ce terrain-là aussi, nous sommes en train de mener une vraie transformation organisationnelle : à l’avenir, ils ne seront plus affectés à tel ou tel métier spécifique, mais seront au service de toutes nos énergies. Électricité comprise.
Enfin, l’empreinte mondiale du groupe est un atout essentiel. Elle nous permet de saisir des opportunités partout sur la planète, notamment grâce aux liens tissés depuis des années, sur nos métiers traditionnels. Il n’est pas rare, désormais, qu’à la faveur d’une visite au Qatar, en Irak ou en Arabie Saoudite, mes interlocuteurs me parlent de projets dans le solaire ou l’hydrogène… Et croyez-moi, pour eux, Total n’est pas moins légitime qu’un électricien en la matière.

Je le précise parce qu’étonnamment, certains semblent penser que seules les entreprises vertes sont capables d’assurer la transition énergétique. C’est frustrant, et c’est surtout stupide. Regardez ce qui se passe dans le secteur automobile, confronté lui aussi à des mutations profondes : pensez-vous vraiment que Tesla va réaliser à lui seul la révolution du véhicule électrique ?
Evidemment non ! La production de masse, le vrai changement d’échelle, dépendront de groupes comme Daimler, Volkswagen, Stellantis ou Renault, qui relèveront ces défis parce qu’ils sont plus gros, et parce qu’ils dominent des pans entiers du marché. C’est cela qui fera la différence ! Et je pense exactement la même chose pour la transition énergétique : il y a de la place pour tout le monde bien sûr, mais l’idée qu’elle puisse se faire uniquement grâce à de nouveaux acteurs verts me dépasse…
Exclure par principe un groupe comme Total, refuser d’admettre que l’argent que nous générons peut servir la mutation énergétique, c’est se tirer une balle dans le pied. Sans la force d’entraînement des entreprises comme la nôtre, la transition risque d’attendre longtemps…
Ce discours est loin de faire l’unanimité au sein des majors pétroliers. Malgré les ambitions affichées par certains dans le solaire ou l’éolien, on sent bien que tous les acteurs ne sont pas prêts à faire le « grand saut » vers la neutralité carbone…
Le club des majors pétroliers n’existe plus. Il est en train de se casser entre d’un côté les Européens (Total, BP, et à un degré moindre Shell) qui ont décidé d’investir résolument dans les renouvelables, et des groupes américains qui ne veulent pas aller dans cette direction. Les débats qui agitent aujourd’hui les grandes entreprises du secteur sont parfois violents, et c’est compréhensible car ce sont des choix stratégiques fondamentaux.
Deux visions s’affrontent, très clairement : d’un point de vue purement pragmatique, on peut comprendre que certains continuent à considérer que leur job consiste à produire du pétrole et du gaz tant qu’il y en a, parce qu’on en aura besoin encore longtemps et parce que cela leur permet de distribuer le maximum d’argent à leurs actionnaires. Ce débat-là, nous l’avons eu aussi chez Total.
Mais aujourd’hui il est tranché. Il nous a fallu cinq ans pour l’affirmer clairement, et infléchir notre stratégie en conséquence. Ce n’est pas évident. Quand j’explique que nous faisons le choix de nous positionner en priorité sur le pétrole le moins cher, cela veut dire que nous amputons délibérément notre terrain de jeu sur ce marché, pour dépenser plus dans l’électricité. En même temps, c’est un nouveau métier, une diversification. Je comprends que cela puisse soulever des interrogations…
Des interrogations notamment sur la rentabilité des nouvelles activités. Peut-elle vraiment se comparer à celle des hydrocarbures ? Cette question, beaucoup de vos actionnaires doivent se la poser…
Les projets dans les renouvelables peuvent être aussi rentables que dans le pétrole ou le gaz, voire plus. C’est un faux débat, qui m’énerve un petit peu, pour tout vous dire… Je me demande si ceux qui véhiculent cette idée ne sont pas ceux qui craignent que nous allions dans ce secteur, c’est-à-dire les électriciens habitués à des rentabilités plus faibles que les pétroliers.
En réalité, tous les investissements que nous faisons en ce domaine affichent une rentabilité sur capital d’au moins 10%. Je peux vous dire que depuis 2015, nos activités pétrolières n’ont pas dégagé 10% de rentabilité. En 2020, ce n’est pas glorieux, mais on était plutôt proche des 4%… Par ailleurs, alors que le marché pétrolier est toujours plus volatil, les renouvelables se développent aujourd’hui principalement à travers des contrats d’achat garantis. Cela nous permet d’ajouter dans notre business model une couche de revenus stables.
Je crois que les analystes et nos actionnaires commencent à comprendre les vertus de cette stratégie. Reste à les convaincre que nos ambitions nouvelles ne nous amèneront pas à faire du volume à tout prix, sans nous préoccuper de la rentabilité intrinsèque des projets. Cela suppose d’être sélectifs, de savoir dire non à certains dossiers, ce que nous faisons. Quand j’évoque une bulle sur les renouvelables, je sais de quoi je parle !
Vous affichez de grandes ambitions dans l’électricité, mais il est une source d’énergie que vous n’évoquez jamais qui est le nucléaire. Avez-vous définitivement tourné le dos à cette filière ?
Sur le fond, aucun doute, face aux défis climatiques, je pense que le nucléaire à un rôle à jouer, qu’il a sa place. Mais il s’agit d’une filière très particulière. Par nature, les enjeux de sûreté, la gestion des déchets radioactifs, les problématiques de démantèlement nécessitent l’intervention des Etats, qui doivent avoir leur mot à dire sur ces sujets. Je ne vois pas ce que Total pourrait apporter en ce domaine, et honnêtement, je vois d’ici les tempêtes que cela soulèverait !
Je crois que nous avons suffisamment de chats à fouetter. Cela ne m’empêche pas d’entendre les professions de foi des uns et des autres, j’ai vu que Bill Gates avait investi dans des start-up de nucléaire modulaire ou de fusion… Je suis de près ces innovations. L’idée d’un nucléaire décentralisé, à base de petits réacteurs, est peut-être une piste intéressante. Par principe, je ne ferme jamais de porte – nous avons fait cette bêtise il y a quelques années avec l’éolien offshore et nous nous en sommes mordu les doigts -, mais aujourd’hui le nucléaire reste loin de nous.
Vous venez de faire référence à Bill Gates, dont vous avez salué le dernier manifeste, appelant à une mobilisation globale des entreprises pour le climat. Concrètement, sur quoi peut déboucher ce type d’initiatives ?
On ne peut qu’applaudir la démarche de Bill Gates, qui ne se contente pas d’éveiller les consciences, mais qui est dans le concret. L’ingénieur qu’il est veut faire la transition. Face au changement climatique, il y a beaucoup d’incantations, d’envolées messianiques. J’observe aussi une surenchère de promesses, avec ce nouveau mantra de la neutralité carbone en 2050. Mais c’est loin, 2050. La vraie question, pour nous, industriels, est : « que fait-on dans les dix ans qui viennent ? »

En tant que patron de Total, voilà un horizon sur lequel je peux m’engager : en l’occurrence, je veux être capable de réduire effectivement les ventes de produits pétroliers de 30 % en Europe dans la décennie à venir, et de construire 100 GW de capacités électriques renouvelables – l’équivalent de plus de 50 centrales nucléaires.
Et je serai jugé là-dessus. Vouloir dessiner le paysage énergétique de 2050, en se basant uniquement sur les technologies connues aujourd’hui, serait une erreur. Il y a vingt ans, aucun professionnel du secteur n’aurait parié sur l’explosion du pétrole et du gaz de schiste. Et dans le monde de l’énergie, qui parlait sérieusement de solaire ou d’éolien flottant ?
Avez-vous le sentiment de mettre votre entreprise en risque en fixant cette feuille de route ?
Non, je ne mets pas l’entreprise en risque. Je la sais solide. Lors du choc pétrolier de 2015 et l’année passée, j’ai pu mesurer sa capacité de résilience. Et c’est parce que les fondamentaux de Total sont solides que nous pouvons envisager de faire évoluer son modèle. Encore une fois, il ne s’agit pas de tourner le dos au pétrole du jour au lendemain. Si je prenais une décision aussi radicale, vous pourriez vous inquiéter… Nous voulons anticiper une transformation inéluctable. Ne pas avoir de regret.
La vague des énergies nouvelles est déjà là ; elle ne va faire que croître, elle est exponentielle. Il faut la prendre au plus vite. Démarrer maintenant, à grande échelle. Je ne considère pas que je mette l’entreprise en danger en investissant plus de 2,5 milliards dans les renouvelables cette année. On pourrait me reprocher de ne pas investir cette somme dans notre métier de base, ou de ne pas le rendre à nos actionnaires, c’est vrai, mais nous prenons un autre chemin.
Source : lexpansion.lexpress.fr