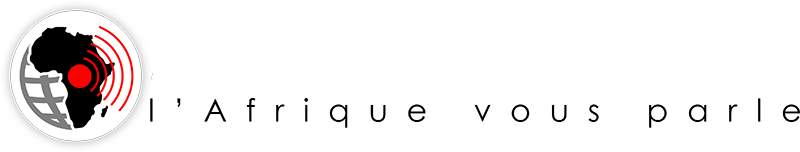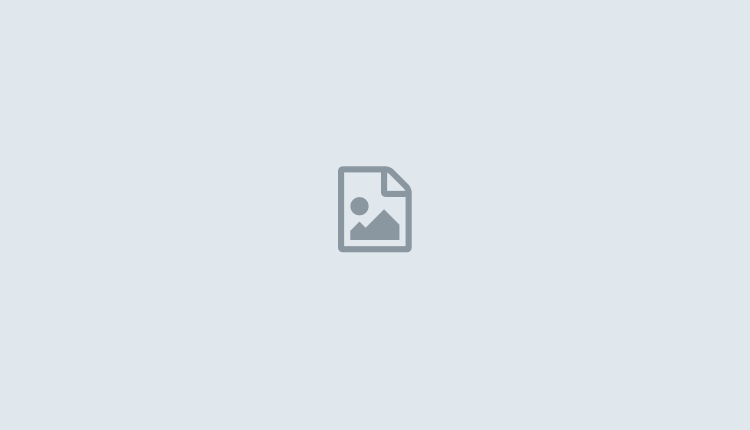Affaire Bouaké: Pourquoi la France a voulu faire disparaître très vite toute preuve
Deuxième volet de notre enquête sur le bombardement de Bouaké, épisode-clé de la crise ivoirienne et de l’histoire récente entre la France et la Côte d’Ivoire. Le 6 novembre 2004, l’armée ivoirienne bombarde un camp français de la force Licorne à Bouaké. Neuf soldats français et un Américain sont tués, 38 personnes blessées. Après 11 ans d’instruction, que sait-on? Quelles zones d’ombre persistent ? RFI revient sur cet épisode tragique. Une enquête en 5 volets d’Anthony Lattier, avec le concours de Frédéric Garat.
« Ce 6 novembre, c’était la surprise. On a pas eu le droit de faire de sport, on ne sait pas pourquoi. On n’avait pas le droit non plus d’accéder à notre foyer, là où on buvait un café. C’était fermé. Je suis allé voir mon chef. Il ne savait pas pourquoi. » Onze ans après le bombardement qui l’a blessé au pied, la fermeture du bâtiment reste toujours une énigme pour ce soldat français. C’est en effet ce bâtiment qui a été pris pour cible par les avions de l’armée ivoirienne le 6 novembre 2004.
« Le bâtiment visé était fermé. C’était la seule et unique fois. Jusqu’à aujourd’hui, on ne sait pas qui a donné l’ordre. C’est ça qui a commencé à me faire réfléchir », raconte maître Jean Balan, qui ferraille depuis le début sur ce dossier. L’avocat de la plupart des parties civiles en est aujourd’hui persuadé, ce bâtiment a été fermé de façon préventive pour qu’il n’y ait pas de victimes. Il pense que « l’idée était de faire bombarder un bâtiment vide du camp français afin de pousser Gbagbo dehors. Cela devait servir de prétexte pour le destituer. Les morts n’étaient pas prévus. La manipulation a tourné à la bavure. »
Le foyer fermé exceptionnellement ? Pas le droit de faire du sport ? Les officiers français expliquent : « L’aviation ivoirienne frappait des cibles à Bouaké depuis trois jours [voir première partie]. Le matin du 6, une opération de regroupement des ressortissants avait été déclenchée. Dans ces cas-là, il est normal que les activités soient limitées », affirme le général Poncet, à l’époque patron de la force Licorne. Le général Henri Bentégeat, alors chef d’État-major de l’armée française, renchérit : « De toute façon, un avion de combat qui bombarde une base quelle qu’elle soit ne peut pas, sauf s’il dispose de munitions guidées lasers, faire de choix entre différents bâtiments. Il arrose forcément extrêmement large ! »
Absence d’autopsie
Significatif ou non, cet élément troublant est le premier d’une affaire qui en compte de nombreux. À commencer par le sort qui a été réservé aux dépouilles. Dans les décombres du camp français, 9 militaires sont retrouvés morts : 5 appartenaient au RICM de Poitiers, trois au 2e RIMA du Mans et un au 515e régiment du train de La Braconne. Un civil américain de Bouaké qui était venu se réfugier au camp français a lui aussi été tué. Les corps des militaires français sont mis dans des sacs. Personne ne les examinera par la suite.
L’autopsie, pourtant réclamée le 7 novembre par un officier français, ne sera jamais pratiquée. « Dès le 6 novembre, une enquête était diligentée du chef de » crime flagrant » par la Gendarmerie Prévôtale de Port-Bouët [le camp principal français à Abidjan], explique maître Jean Balan. Or, dans une affaire d’assassinat, l’autopsie est obligatoire ! Elle n’a pas eu lieu. On peut comprendre l’émotion des militaires sur place. Mais une fois les corps rapatriés à Paris, rien n’empêchait que cela ne fût fait ».
Ayant eu accès aux photos des dépouilles, deux familles découvrent par hasard, un an après le bombardement, que les corps de leurs proches ont été inversés. L’exhumation des corps en donnera la douloureuse confirmation. « On s’est alors rendu compte que les militaires avaient été enterrés » comme des chiens « , les vêtements déchirés, couverts de sang, sans lavement post mortem, relève Jean Balan. Le sort réservé aux dépouilles démontre un empressement, comme si toute preuve devait disparaitre très vite. »
Le président Jacques Chirac (d) et le général Henri Poncet à la base aérienne de Creil en France le 30 septembre 2002. © Etienne de Malglaive/Getty Images
Le général Poncet justifie la décision : « Qu’aurait démontré l’autopsie ? Que les victimes avaient été tuées par les avions ivoiriens… Il faut comprendre que sur le moment, la priorité a été donnée au rapatriement des blessés, en même temps qu’on lançait un raid héliporté sur Yamoussoukro, qu’on empêchait le franchissement des ponts d’Abidjan, qu’on prenait le contrôle de l’aéroport et qu’on commençait l’évacuation des expatriés ! »
« Ne pas faire d’autopsie, c’est contraire à l’éthique du soldat, estime de son côté le général Renaud de Malaussène, numéro 2 de Licorne à partir de janvier 2005. Dans l’armée, on respecte nos morts. Pourquoi ne pas les autopsier ? Peut-être pour être sûr que personne ne puisse démontrer que ce ne sont pas les avions de Gbagbo qui ont tué les soldats français ? Je m’interroge. » Maître Balan affirme lui aussi qu’ « on a voulu s’assurer qu’aucune autre trace venant d’une autre munition puisse être retrouvée. Sinon, toute la légitimité du plan initial, qui était de destituer Gbagbo, s’effondrait ».
Arrêtés puis relâchés?
À l’aéroport de Yamoussoukro, les militaires français en poste sont mis au courant du bombardement grâce au réseau radio de la force Licorne : « Les avions n’étaient pas encore revenus que nous savions déjà qu’ils avaient bombardé Bouaké », affirme devant la juge d’instruction un Français qui surveillait les allers et venues des Sukhois. Sur les photos et les films réalisés par les services français, on voit les deux pilotes biélorusses et les deux copilotes ivoiriens sortir tranquillement du cockpit. Les boîtes des appareils ont-elles été récupérées ? La France a-t-elle appréhendé l’équipage ce jour-là avant de le relâcher ? « Absolument pas ! répond le général Poncet. Le petit détachement français composé de 60 hommes était en bout de piste, à deux kilomètres des parkings où sont allés se garer les avions. Et tout autour, il y avait des centaines de militaires ivoiriens. »
Où sont allés les pilotes ? On sait qu’ils se sont rendus à Abidjan pour ensuite quitter le pays. Pour l’avocat Jean Balan, « ils n’ont pas pu sortir du pays sans une complicité française. C’est une impossibilité physique ! » Dans un témoignage recueilli par nos confrères de Canal Plus, l’Ivoirien André Ouraga, qui traduisait les propos de l’équipage du russe au français, affirme que les pilotes sont restés dans une « base militaire d’Abidjan contrôlée par l’armée française » : « Ils [les Français] ne nous ont pas brutalisés. Ils nous ont dit : » Vous restez sur place « ». Une source du milieu du renseignement nous a confirmé cette information. Une opération d’exfiltration a-t-elle été organisée ? Et par qui ? Aucune preuve n’existe à ce jour.
Empressement
Il est avéré cependant que les militaires de Licorne ont détenu pendant 4 jours 15 personnes (9 Ukrainiens, 4 Biélorusses, 2 Russes). Liés à l’équipage de Yamoussoukro, ils ont été interpellés quelques heures après le bombardement, au moment de la prise de l’aéroport d’Abidjan par l’armée française. Munis de faux papiers d’identité, ils sont « auditionnés par les forces françaises », reconnait le directeur de la DGSE devant la juge. Mais sur le document déclassifié de leur interrogatoire, toutes les lignes sont barrées au feutre noir…« C’est un pied de nez, commente Jean Balan, ils ont été entendus, mais on ne saura jamais ce qu’ils ont dit ». « Cela aurait pu donner des éléments intéressants sur la motivation de l’attaque de l’emprise française », regrette aussi la juge Sabine Kheiris dans son ordonnance du 2 février 2016, que RFI a pu consulter.
« Paris m’a demandé instamment de relâcher ces 15 personnes, arguant qu’on n’avait aucune autorisation pour les détenir, raconte Henri Poncet. Je me suis même fait engueuler parce que je ne les libérais pas assez vite ! » Pourquoi cet empressement ? La pression diplomatique des représentants russes en Côte d’Ivoire, assure l’ambassadeur français Le Lidec. Pour maître Balan, l’argument ne tient pas : « Le ministre de la Défense biélorusse a fait une déclaration le 10 novembre pour dire en gros que le sort de ces mercenaires ne concernait pas son pays ».
Autre argument avancé, l’absence de cadre juridique pour arrêter des suspects hors du territoire français. Le général Poncet n’est pas convaincu : « La loi Pelchat précise que tout mercenaire qui s’en prendrait à des intérêts français et en particulier à des soldats français est passible de la justice française. Il y avait évidemment une base légale pour les arrêter. On ne s’est, d’ailleurs, pas posé la question quand il s’est agi de traduire devant la justice des pirates somaliens… » Le général Poncet conteste la décision de Paris qu’il a appliquée : « J’aurais très volontiers remis ces mercenaires à la justice pour qu’on puisse remonter la filière du mercenariat et peut-être remonter jusqu’aux pilotes coupables d’avoir bombardé la position française. »
Les pilotes, justement, s’apprêtent à quitter la Côte d’Ivoire pour passer au Togo, lorsque les autorités de ce pays les arrêtent et les mettent à la disposition de la France. C’est l’épisode clé de l’enquête de la juge Kheiris : il ferait porter la responsabilité de leur fuite sur les épaules de trois anciens ministres de Jacques Chirac : Michelle Alliot-Marie, Dominique de Villepin et Michel Barnier. Dans quelles circonstances cet épisode troublant s’est-il déroulé ? Sur quels éléments s’appuie la justice ?
Source: RFI
Le titre est de la rédaction